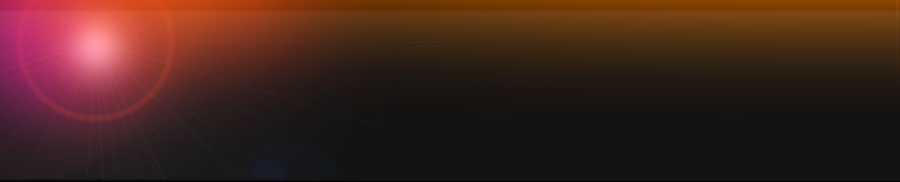Maldoror - Le comte de Lautreamont
À l’aube de ce XXe siècle, les textes du jeune Isidore Ducasse résonnent encore avec une actualité troublante, devant la crise morale que traverse la société actuelle :
« J’ai vu pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes [...] abru- tir leurs semblables, mettre l’or d’autrui dans la poche et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions : la gloire. [...].
J’ai vu les hommes [...] surpasser la dureté du roc, la cruauté du requin, [...] la fureur insensée des criminels, les tra- hisons de l’hypocrite, [...]. Je les ai vus tous [...] n’oser émettre les méditations vastes et ingrates que recelait leur sein, tant elles étaient pleines d’injustices et d’horreurs [...]. »
Fulgurance baroque des images mortifères, humour des situations extrêmes et blasphématoires, flamboyance d'un bestiaire fantasmagorique, vision anarchique d'un monde en décomposition... Autant d'éléments pour faire de Lautréamont, au lendemain des charniers de la Première Guerre Mondiale, un
des pères du Surréalisme, aux yeux de Breton, Aragon, Desnos, Soupault et, par la liberté de son style, un des auteurs fondateurs de la littérature contemporaine.
Maldoror - Un Révolté dans un monde révoltant
Les chants de Maldoror - Une épopée

Ces six Chants grandioses, flamboyants, constitués de 70 strophes écrites en prose lyrique dans un des plus purs styles de la langue française, marquent à jamais la littérature, au fer rouge.
Œuvre d'un jeune auteur de 21 ans, héritier du courant le plus noir du romantisme, elle met en scène le personnage de Maldoror, sorte de génie du Mal doué de tous les pouvoirs de transformation (aigle, crabe tourteau, poulpe géant ou femelle requin) pour répandre sur le monde « son souffle empoisonné ».
L'intention est clairement exposée : choquer et interpeller le lecteur par l'accumulation de provocations, violences gratuites, profanations, mettre en évidence toute la noirceur et le dégoût profond qu'inspirent à l'auteur les débordements de l'âme humaine et fustiger ainsi la Divinité, responsable de ce chaos.
Et pourtant, au-delà de cette intention de provocation, certains fragments des Chants de Maldoror laissent entrevoir la fascination profonde de l’auteur devant les merveilles et l’immensité de la Nature, de l’Océan en particulier, exprimée alors en des pages d’un lyrisme exacerbé. Cette fascination se transforme vite en interrogation quasiment mystique sur l’infini, sa place dans l’univers, son propre destin dans ce maelström chaotique.
Isidore Ducasse (comte de Lautréamont en littérature) naît à Montevideo, en Uruguay (comme Jules Supervielle et Jules Laforgue), en 1846. Il fait partie, avec Arthur Rimbaud, son exact contemporain, des étoiles filantes de la littérature française.
Il a un an et demi quand sa mère se suicide. Son père, chancelier au Consulat général de France, l’envoie, à l’âge de treize ans, poursuivre ses études en France. Il restera six années
« prisonnier en internat » dans deux lycées impériaux à la discipline de fer : Tarbes (berceau de la famille Ducasse) puis Pau. Ces années d'isolement développeront, dans l'esprit du jeune adolescent, le sens de la rêverie et le goût de la révolte la plus extrême et la plus radicale. Il est décrit à cette époque comme « un grand jeune homme mince, le dos un peu voûté, le teint pâle, les cheveux longs tombant en travers sur le front, la voix aigrelette. D'ordinaire triste et silencieux, comme replié sur lui-même, il passait des heures entières, les mains sur le front, les yeux fixés sur un livre qu'il ne lisait point; on voyait qu'il était plongé dans une rêverie. »
Après un bref retour en Uruguay, il réapparait à Paris en tant qu'homme de lettres en 1867. Il publie alors, à compte d'auteur sous le pseudonyme du Comte de Lautréamont, le Chant premier des Chants de Maldoror. En 1869, Albert Lacroix, éditeur des six Chants de Maldoror, terrorisé par la violence et l'audace du texte, renoncera à diffuser les exemplaires par crainte du Procureur Général.
Isidore Ducasse meurt à 24 ans pendant le siège de Paris. Il faudra attendre 1977 pour enfin découvrir (grâce aux recherches de J.J. Lefrère) la seule et unique photo (qui reste néanmoins aujourd’hui contestée) du sulfureux Comte de Lautréamont. Pour tous les lecteurs des Chants de Maldoror (A. Jarry, les surréalistes, A. Gide, J.P. Sartre, A.Camus et bien d'autres), il est resté pendant plus d'un siècle : l'écrivain sans visage.